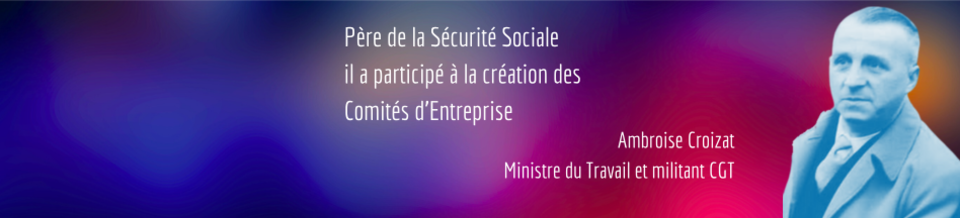CGT
Nos revendications sont majoritaires et doivent être appliquées (25 Juil. 2024)C’est l’heure de défendre nos exigences sociales Nos conditions de travail se détériorent, nos salaires ne suivent pas l’inflation, nos services publics disparaissent peu à peu, les plans de licenciements se multiplient… Ça suffit ! Contre le poison de la division : le RN est comme les patrons, il cherche à diviser les salarié·es, selon notre origine, notre religion ou notre orientation sexuelle… À l’écouter, le privilégié c’est toujours le travailleur immigré, jamais les plus fortunés Rien n’est jamais joué d’avance : alors que tous les médias aux mains des milliardaires nous prédisaient la victoire de l’extrême droite, le sursaut populaire a déjoué tous les pronostics. Le Président doit maintenant respecter le choix des urnes Nous voulons un gouvernement qui réponde aux exigences sociales ! Déjà de premières avancées : par notre mobilisation, nous avons gagné l’abandon de la réforme de l’assurance chômage et le fait que les prix de l’électricité ne vont finalement pas être augmentés en août ! S’il y a bien une majorité dans le pays, c'est celle en faveur de ces mesures sociales Comme les congés payés, ce qui paraissait impossible il y a des années peut être gagné par les salarié·es mobilisé·es. Dans nos entreprises et nos services, discutons avec les collègues et portons ces propositions. Dans l’unité syndicale, la CGT va proposer une grande journée de mobilisations à la rentrée, pour maintenir la pression populaire et faire gagner ces avancées. Maintenant, nous voulons vivre mieux, il y a urgence à : Indexer les salaires sur les prix, comme pour le Smic, tous les salaires doivent à minima suivre l’inflation. Augmenter les salaires et les pensions pour vivre de son travail et de sa retraite, et réaliser l’égalité salariale entre les femmes et les hommes alors que les dividendes atteignent des records en France. Ce sont les travailleurs qui produisent la valeur, la partager c’est augmenter les salaires. Supprimer la réforme des retraites à 64 ans, passée en force l’année dernière à coup de 49-3, et aller vers un retour à 60 ans. Améliorer les conditions de travail en rétablissant les CHSCT. Investir dans nos services publics sur tous les territoires. Partout nous voulons des moyens pour nos écoles, nos hôpitaux… Réindustrialiser le pays pour répondre au défi environnemental en commençant par mettre un moratoire sur tous les plans de licenciements en cours. → Télécharger le tract
 [ Assemblage Indd ]
[ Format jpg ]
[ Format PDF pour impression ]
[ Format PDF pour impression avec traits de
coupe ]
[ Format pdf - affichage numérique ]
Pour être plus fort encore : on se syndique, on s'organise avec la CGT
C’est le moment de se syndiquer pour se protéger, participer et agir !
En tant que salarié·es, notre force c’est notre nombre. Pour être plus efficaces, ne plus être isolé face à l’employeur, organisons-nous dans nos entreprises et nos services en nous syndiquant et
en préparant les élections professionnelles.
→ Se syndiquer
,
La CGT appelle le Président de la République à respecter le choix des urnes
Ce mardi, Emmanuel Macron a choisi de s’exprimer à quelques jours du début des Jeux Olympiques. Dans son allocution, le président de la République continue de nier le résultat des urnes et
confirme le maintien d’un « gouvernement technique » alors même que le Nouveau Front Populaire faisait une proposition de Première Ministre quelques heures avant.
Lire le communiqué de
presse
[ Assemblage Indd ]
[ Format jpg ]
[ Format PDF pour impression ]
[ Format PDF pour impression avec traits de
coupe ]
[ Format pdf - affichage numérique ]
Pour être plus fort encore : on se syndique, on s'organise avec la CGT
C’est le moment de se syndiquer pour se protéger, participer et agir !
En tant que salarié·es, notre force c’est notre nombre. Pour être plus efficaces, ne plus être isolé face à l’employeur, organisons-nous dans nos entreprises et nos services en nous syndiquant et
en préparant les élections professionnelles.
→ Se syndiquer
,
La CGT appelle le Président de la République à respecter le choix des urnes
Ce mardi, Emmanuel Macron a choisi de s’exprimer à quelques jours du début des Jeux Olympiques. Dans son allocution, le président de la République continue de nier le résultat des urnes et
confirme le maintien d’un « gouvernement technique » alors même que le Nouveau Front Populaire faisait une proposition de Première Ministre quelques heures avant.
Lire le communiqué de
presse
>> Lire la suite
Transports pendant les JOP : quelles difficultés pour les salarié·es ? (24 Juil. 2024)
Le réseau de transports d'Île-de-France déjà en tension L’organisation des transports est donc un défi majeur dans un contexte où le réseau est déjà en continuelle tension : tension sur le réseau qui est à saturation, tension sur les effectifs avec notamment une pénurie de conducteurs de bus, tension sur le matériel (ferré, bus et cars) sous-dimensionné et vieillissant. Une équation compliquée à résoudre d’autant que les JOP se dérouleront en période estivale et en pleine vacances scolaires. Si la majorité des épreuves se dérouleront à Paris et en Ile-de-France, 8 sites de la métropole seront aussi concernés (Lille, Lyon, Saint Etienne, Bordeaux, Marseille, et Nice) ainsi que Tahiti. Cela conduira à de multiples déplacements sur l‘ensemble du territoire. Pour rappel, le dossier de candidature déposé par la ville de Paris comportait des objectifs ambitieux en termes d’environnement, de transports et d’accessibilité : 100% des spectateurs devraient avoir accès aux sites olympiques en transports en commun ou à vélo, une heure maximum pour sortir d’un site, déploiement de voies dédiées avec aménagement de taxis et bus pour le transport de personnes à mobilité réduite. Ces engagements s’appuyaient sur : Le respect du calendrier de déploiement du Grand Paris Express (prolongement du RER E et de la ligne 14 du métro et de la mise en service des lignes 15, 16 et 17). La mise en service du CDG express (Charles de Gaulle-Paris Est) Des travaux d’aménagement de la voirie pour créer des pistes cyclables L’extension des horaires de services de transports, l’augmentation des fréquences de passage et l’application de fréquences maximales De tels objectifs nécessiteraient un réseau de transport ferré, routier et fluvial rénové et développé tel que le porte la CGT pour répondre aux besoins quotidiens des usagers et usagères fancilien∙nes et ainsi permettre un véritable report modal sur la durée, profitant de manière pérenne aux déplacements des travailleur∙ses et des citoyen∙nes. Aujourd’hui, à la veille de l’ouverture des JOP seuls les prolongements de la ligne E du RER et de la ligne 14 du métro sont opérationnels ce qui laisse présager des difficultés d‘exploitation et d’engorgements des réseaux. Des transports par la route 185 kms de routes (nationale, départementale, une partie du périphérique, autoroute A1, et voiries de la ville de Paris) sécurisés seront réservés aux athlètes et des accrédité∙e.s sur lesquels circuleront 1000 bus et cars. Mais également plus de 400 bus en voie de retrait de service aménagés pour le transport des athlètes paralympiques et plus de 2740 véhicules individuels. Tout ceci nécessitera des centaines de conducteurs supplémentaires et c’est bien la que le bât blesse en lien avec l’attractivité des métiers. Les voies réservées feront l’objet de contrôles, avec des amendes à la clé. La possible saturation du réseau de transports terrestres ferré et routier Une solution expérimentale par les airs est envisagée par la mise en service de taxis volants (mix hélicoptère, drone) électriques pour assurer la liaison entre l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et l’aéroport du Bourget et l’héliport de Paris au quai d’Austerlitz (barge flottante aménagée). Plutôt que de valoriser les transports collectifs une sélection par le prix se fera pour une clientèle de privilégiés. On est loin de l’esprit olympique et populaire Quelques exemples de points de vigilance pendant la période de jeux olympiques sur le périmètre des transports Activité collecte des déchets sur la région parisienne pour les villes concernées par les JOP est assurée par des entreprises privées (fédération des transports) et des salarie∙es du service public, à ce jour aucune disposition n'a été prise sur le surcroit d'activité renvoyant à l'organisation des collectes comptes tenu des restrictions d'accès dans certaines zones. (Effectif, itinéraires, horaires de collecte) Activité transport urbain la plupart des réseaux concernés par les JOP les opérateurs d'exploitation (RATP KEOLIS TRANSDEV) ont acheté la paix sociale par l'attribution de primes liées généralement à l'assiduité qui de fait risque d'annihiler toutes perspectives de mouvements sociaux. Une remarque sur la politique tarifaire sur l'ile de France pendant les jeux olympiques ou le prix du ticket est multiplié par deux. Nous pouvons nous interroger sur cette mesure transitoire décidée par la région sur sa pertinence et son devenir. Il est à noter que pour ce secteur le manque d’attractivité du métier de conducteur de bus met l’emploi sous tension. En effet, les conditions sociales (salaires, conditions de travail…) sont la cause du mal. D’une part, les contraintes de services publics ne sont pas ou plus compensées et, d’autre part, l’ouverture à la concurrence des réseaux amènent les entreprises à baisser leur coût pour tenter de remporter les parts de marché. Activité transports routiers voyageurs de nombreux conducteurs de province ont été sollicités sur la base du volontariat pour renforcer les dessertes sur Paris notamment (KEOLIS TRANSDEV RATP DEV) ces deux groupes faisant appel à des conducteurs régionaux ou étrangers. Au-delà des problèmes liés aux modifications de contrats de travail ces ressources utilisées pendant les jeux olympiques seront des moyens en moins pour assurer les dessertes scolaires en province lors de la rentrée scolaire. Activité transports routiers de marchandises et de logistique il pourrait y avoir des restrictions de circulation sur les jours de grands départs, d’accès à certaines zones pendant les jeux olympiques. Sur la région parisienne, des risques de congestion du trafic routier compte tenu de la mise en place de voies de circulation réservées aux délégations aux taxis et services prioritaires. Les entreprises seront invitées à reporter les livraisons dans certaines zones : ce qui entraînera des conséquences sur l’organisation du travail et les rythmes horaires Une table ronde a fait suite au lendemain d’une forte mobilisation des cheminotes et cheminots d’Île-de-France afin d’exiger des moyens pour assurer la production dans le respect de la réglementation du travail et une reconnaissance financière de la part de l’entreprise. Les transports aériens Sur les aéroports parisiens l'accessibilité par la route sera compliquée compte tenu du trafic quotidien déjà surchargé ; l'augmentation significative du trafic passagers sur la période des jeux olympiques et paralympiques sera l'un des points tension Aéroports de Paris a lancé un appel au volontariat auquel 3 000 salarié·es ont répondu pour absorber le trafic passagers et l'accueil des délégations. Les volontaires ADP seront mobilisés dès le 8 juillet jusqu’à la fin des jeux paralympiques : quid de leur temps de travail et de leurs missions quotidiennes. Sur les activités des sous-traitants liées à l'aérien (livraisons bagages, sureté, de nettoyage …) pas de renforts d'effectifs et une organisation du travail à flux tendu. Les livreurs à vélo Aucunes informations pour les livreurs à vélo sur les possibilités de continuer d'exercer leurs activités dans les zones d'accès restreintes et d’emprunter les voies réservées (lieux où se tiennent les épreuves olympiques). Les livreurs motorisés devront demander un pass : en sera-t-il de même pour les travailleurs étrangers et sans-papiers ? Pour un certain nombre de ces secteurs, la communication des entreprises est peu prolixe sur la volonté de faire appel aux retraité∙es, de reporter les départs en retraite, de reporter la prise de congé pendant les mois de juillet et d’août de distribuer des primes à celles et ceux qui accepteraient des dérogations à la réglementation du travail pour absorber la surcharge de production pendant la période. Point juridique La loi ne prévoit pas de motif de retard spécifique aux perturbations engendrées par la tenue des Jeux Olympiques. Le ministère des Transports a mis en place un site dédié : (https://anticiperlesjeux.gouv.fr/) à l’organisation des Jeux mais, s’il anticipe déjà de fortes perturbations des transports et des restrictions de circulation, il ne prévoit aucune mesure contraignante pour les employeurs. Attention, si vous craignez des sanctions pour des retards liés à l’organisation des JO, il peut être utile de garder la preuve : Des perturbations des transports le(s) jour(s) des retards, Des heures de départ du domicile afin d’attester de sa bonne foi, Des éventuelles demandes d’aménagement temporaire de poste lorsque ceux-ci sont possibles (télétravail, demande de changement d’horaires, etc..). Certaines zones, situées à proximité des lieux d’accueil des épreuves, seront en accès restreint et nécessiteront un enregistrement préalable auprès de la préfecture de Police. Pour les salarié·es : Le Ministère a fait le choix de laisser la charge aux salarié∙es dont les déplacements seraient impactés de solliciter un pass d'accès (https://www.pass-jeux.gouv.fr/), l'employeur est tenu de fournir un justificatif employeur ou de mission afin que le ou la salarié∙e soit en mesure de justifier sa demande. Pour nos élu·es et mandaté·es : Il existe une disposition qui permet à l’employeur de demander des accréditations permanentes pour tous·tes les élu·es et mandaté·es qui leur permettra d’accéder aux sites dans la limite de leur périmètre d’intervention et de leurs prérogatives. C’est l’entreprise d’appartenance des instances représentatives du personnel qui recense et dépose les demandes d’accréditation auprès de Paris 2024. Les modalités d’accès aux périmètres de sécurité ne sauraient exclure la circulation des élu∙es et mandaté∙es syndicaux sur les lieux de travail où ils et elles sont amené∙es à exercer leur mandat, sauf à porter atteinte à la liberté syndicale et au droit à la représentation. Analyse CGT Un des enjeux de ces JOP est d’en limiter au maximum l’empreinte écologique. C’est pourquoi, la volonté première du Comité d’organisation était de faire la part belle aux vélos et permettre l’accès à tous les sites de compétition. Un objectif de plus dont la réalisation se révèle aléatoire. Le retard dans la réalisation de certains travaux nous amène à nous interroger sur le financement de certains projets de leurs conséquences sur l’offre de transports. Un des moyens de contourner cette difficulté est de faire baisser la demande quotidienne de transports voyageurs et marchandises pendant cette période chez les francilien∙nes pour absorber l’afflux de voyageur∙ses. Les salarié∙es ne concourant pas à la réalisation des JOP seront donc invité∙es à poser des congés ou à télétravailler : nous pouvons nous interroger sur la liberté de choix et sur la compatibilité des espaces de travail à domicile. L’objectif de la charte sociale disponible ici signée entre les organisations syndicales, patronales et le comité d’organisation des JOP qui était « de placer l’emploi de qualité et les conditions de travail des salariés au cœur de l’impact socio-économique des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ». Même si celle-ci n’est pas contraignante mais il est bon de rappeler qu’elle a tout de même été signée par le patronat. L’organisation des JOP ne doit pas être le laboratoire de la déréglementation du travail, le Comité d’organisations des Jeux Olympiques et Paralympiques souhaite que ces jeux soient exemplaires d’un point vue environnemental : faisons en sorte qu’ils le soient pour les conditions de vie et travail des salarié∙es. → Besoin de plus d'informations ? Consultez le dossier complet "Jeux olympiques : le droit du travail ne peut pas être hors-jeu" → Des questions ? La CGT met en place un numéro vert pour tous les salarié·es : 0 801 230 526 du 22 juillet au 9 août inclus, du lundi au vendredi de 9h à 17h. → Accédez à la foire aux questions sur les JOP Téléchargement-s . ( - Lu) Télécharger ,
>> Lire la suite
Contactez la CGT pendant les JOP (22 Juil. 2024)
→ Accéder au dossier Jeux olympiques : le droit du travail ne peut pas être hors-Jeu Numéro vert 08 01 23 05 26 du lundi au vendredi de 9h à 17h du 22 juillet jusqu’au 9 août. Accueil physique / antennes locales CGT ouvertes cet été Paris (75) Adresse : 1 Rue de Nantes, 75019 Paris Tel : 09 65 32 98 93 Dates d'ouverture : 22 juillet au 13 aout 2024 Horaires : 9 h - 18 h Aubervilliers (93) Adresse : 92 Av. Victor Hugo, 93300 Aubervilliers Tel : 01 48 34 35 99 Mail : cgt.aubervilliers@wanadoo.fr Dates d'ouverture : Les mercredis 24, 31 juillet et 7 aout Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h Saint-Denis (93) Adresse : 9-11 rue Genin 93200 Saint-Denis Tel : 01 55 84 41 13 / 01 55 84 41 14 Mail : contact@ulcgtsaintdenis.fr Dates d'ouverture : lundis 22,29 juillet et 5 aout , mercredis 24 juillet et 7 aout, jeudis 25 juillet, 1er et 8 aout, vendredis 2 et 9 aout Horaires : 14h - 16h30 Saint-Ouen (93) Adresse : 30 rue Ambroise Croizat, 93400 Saint Ouen Tel : 01 40 11 53 32 Dates d'ouverture : Tout l'été Horaires : 9h -12h / 14h - 17h Marseille (13) Adresse : 23 Bd C. Nedelec 13003 Marseille Tel : 04.91.64.70.88 Mail : ud13@cgt13.fr Evry (91) Adresse : 12 Place des Terrasses Agora 91034 Evry Tel : 01.60.78.28.41 Mail : ud91@cgt.fr Horaires : 9h -12h / 14h - 17h Créteil (94) Adresse : 11-13 Rue des Archives 94010 Créteil Tel : 01.41.94.94.00 Mail : infos@cgt94.fr / ud94@cgt.fr Dates d'ouverture : Tout l'été Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h ,
>> Lire la suite
Le syndicalisme est d'utilité publique : avec la CGT je me défends (18 Juil. 2024)
Nos droits ne nous ont pas été donnés mais gagnés par nos luttes Nous, syndiqué·es CGT, partons de notre réalité de travailleur·ses et de nos aspirations. Nous construisons les revendications entre collègues, et nous élaborons ensemble toutes les étapes jusqu’à la conclusion des négociations. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La CGT (@cgt_confederation) Notre force c’est le nombre, pour la faire vivre, on s’organise et on se syndique pour : ↪ se protéger En étant syndiqué·e je me protège face à l’arbitraire de l’employeur. Je ne suis plus seul·e : je fais vivre un collectif solidaire qui se mobilise contre toutes les discriminations. Je suis formé·e et informé·e pour défendre mes droits. ↪ participer Je travaille, je dois aussi pouvoir décider ! La démocratie ne doit pas s’arrêter aux portes de l’entreprise. En me syndiquant je m’organise pour que ma voix et celle de mes collègues soit entendue et respectée. ↪ agir Le syndicalisme est le seul moyen de se mobiliser pour défendre nos droits, vivre nos revendications légitimes et négocier des avancées concrètes sur nos salaires et nos conditions de travail. En étant syndiqué·e, nous cotisons, donc nous contribuons chacune et chacun à un pot commun qui permet de faire vivre toute la CGT (territoires, branches et national). C’est ce qui permet à la CGT d’être indépendante des employeurs et des gouvernements. 1500.00 € de salaire mensuel = 15 € de cotisation par mois (1 %) = 5 € par mois après déduction fiscale de 66 % , Pour construire un syndicat fort et changer nos vies au travail : Je me syndique à la CGT pour rejoindre la plus grande force organisée et démocratique de salarié·es en France. Je construis et renforce la CGT sur mon lieu de travail : je propose l’adhésion à toutes et tous autour de moi pour faire grandir notre force par le nombre. Je me forme avec la CGT pour s’organiser entre salarié·es, échanger sur notre travail, élaborer nos revendications et gagner de nouveaux droits. Pourquoi ? En m’organisant dans mon entreprise et mon service, je crée du lien avec mes collègues et de la solidarité concrète. Ensemble, nous pouvons peser, faire pression sur les entreprises et les gouvernements et changer les choses, en mieux, car nos revendications sont majoritaires dans la population : l’augmentation des salaires et des pensions ; l’indexation de tous les salaires sur les prix ; l’abrogation de la réforme des retraites ; l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes l’investissement dans nos services publics dans tous les territoires ; la réindustrialisation du pays pour répondre au défi environnemental. Je rejoins la CGT , Télécharger le tract et l'affiche
 Affiche format A3
[ Format .jpg ]
[ Format .pdf pour impression avec traits de
coupe ]
[ Format .pdf pour affichage numérique ]
[ Assemblage indd ]
Tract format A5
[ Format .jpg ]
[ Format .pdf pour impression ]
[ Format .pdf pour impression avec traits
de coupe ]
[ Format .pdf pour affichage numérique
]
[ Assemblage indd ]
→ Télécharger les visuels réseaux sociaux
Affiche format A3
[ Format .jpg ]
[ Format .pdf pour impression avec traits de
coupe ]
[ Format .pdf pour affichage numérique ]
[ Assemblage indd ]
Tract format A5
[ Format .jpg ]
[ Format .pdf pour impression ]
[ Format .pdf pour impression avec traits
de coupe ]
[ Format .pdf pour affichage numérique
]
[ Assemblage indd ]
→ Télécharger les visuels réseaux sociaux
 ,
,
>> Lire la suite
FAQ droit du travail et JO : les réponses de la CGT (18 Juil. 2024)
Le gouvernement a d’ores et déjà pris des mesures dérogatoires autorisant les employeurs à contourner le repos hebdomadaire des salarié∙es pendant la durée des Jeux Olympiques, décision contestée par la CGT devant le Conseil d’État. À ce jour, à l’exception de la suppression du repos dominical, aucune autre modification n’a été apportée au droit du travail en vue de la période estivale mais les employeurs sont déjà nombreux à se saisir de ce prétexte afin d’imposer des mesures aux salarié∙es. → Accéder au dossier Jeux olympiques : le droit du travail ne peut pas être hors-Jeu → Obtenez plus d'informations en vous adressant directement à la CGT à proximité des sites olympiques À travers la foire aux questions (FAQ) ci-après, la CGT est là pour rappeler les droits des travailleur∙ses, même pendant les JO ! , 1 - L'employeur peut-il changer mes horaires de travail pendant les JO ? La modification des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, il n’a donc pas besoin de l’accord du/de la salarié∙e. Il peut donc modifier les horaires de travail des salarié∙es pendant les JO. Il faut toutefois que la modification des horaires ne bouleverse pas trop le rythme de travail du/de la salarié∙e (par exemple, passer en horaires de nuit), et n’entraîne pas de conséquences trop graves sur sa vie privée. Également, cette modification des horaires doit respecter un délai de prévenance. Ces questions sont parfois traitées par les accords d’entreprise ou de branche, qui restent applicables pendant les JO. Il convient également de regarder si les horaires sont précisément fixés dans le contrat de travail du/de la salarié∙e. Attention, ces réponses ne sont pas applicables aux salarié∙es à temps partiel. 2- L'employeur peut-il modifier mes jours de repos pendant les JO ? Des dérogations spéciales liées à la période des JO existent pour la suspension du repos hebdomadaire et dominical (cf. questions 3 et 4 dédiées). En dehors de ces exceptions, les rythmes de travail tirés des contrats de travail des salarié∙es, accords d’entreprise ou accords de branche continuent à s’appliquer. 3 - Peut-on me refuser mon repos hebdomadaire ? Sauf dérogation strictement encadrée, chaque salarié∙e doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire. Un décret autorise toutefois les employeurs à suspendre le repos hebdomadaire des salarié∙es pendant les JO, dans la limite de 2 fois par mois. Seront concerné∙es les salarié∙es des établissements connaissant un surcroit extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions ainsi que pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites. Il y a cependant un risque à ce que les employeurs d’autres secteurs cherchent à y déroger, dans les activités de l’audiovisuel à l’hôtellerie restauration en passant par la sécurité privée, les transports et le nettoyage. Attention, les heures travaillées le jour du repos hebdomadaire sont alors considérées comme des heures supplémentaires et doivent être payées comme tel (sauf accord d’annualisation). De plus, les salarié∙es doivent avoir un repos compensateur au moins égal à la durée du repos qui a été suspendu immédiatement après la période dérogatoire, soit après le 14 août 2024. Ces dérogations s’appliqueront du 18 juillet au 14 août 2024, alors que les JO ne se tiennent que du 26 juillet au 11 août 2024 et les épreuves paralympiques du 28 août au 8 septembre. 4 - Peut-on m’imposer de travailler le dimanche ? Si le repos dominical reste le principe, les dérogations sont déjà nombreuses et continueront de s’appliquer pendant les JO. En plus de ces dérogations, la loi relative aux JO a créé un nouveau dispositif de dérogation préfectorale très large, qui s’appliquera pour les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens ou des services (commerce de détail alimentaire, habillements, articles de sport et de loisirs, librairie papeterie …) dans les communes d'implantation des sites de compétition ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites. Le préfet pourra étendre la dérogation à l’ensemble des commerçant∙es de la même branche d’activité que celui qui a fait la demande, situés dans la zone géographie concernée. Ces dérogations s’appliqueront du 15 juin au 30 septembre 2024, alors que les JO ne se tiennent que du 26 juillet au 11 août 2024 et les épreuves paralympiques du 28 août au 8 septembre. Elles sont soumises au volontariat des salarié∙es. Pour l’Ile-de-France, la préfecture a mis à disposition un site internet. 5 - L'employeur peut-il refuser la pose de congés pendant la durée des JO ? Dans beaucoup d’entreprises, les règles de prise et de report des congés des salarié∙es sont régies par accord d’entreprise ou de branche. À défaut d’un accord collectif portant spécifiquement sur la période des Jeux Olympiques, les règles prévues par l’accord d’entreprise ou de branche s’appliquent. À défaut d’accord collectif, l’employeur doit informer les salarié∙es de la période de prise des congés au moins deux mois avant son ouverture et celle-ci doit impérativement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre. De plus, dans ce même intervalle, l’employeur est tenu d’attribuer au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés. L’employeur peut définir l’ordre des départs en congés mais il doit le communiquer à chaque salarié∙e au moins un mois avant son départ. 6 - L’employeur peut-il m’imposer mes congés payés pendant la fermeture de l’entreprise ? Oui, l’employeur peut décider d’une fermeture annuelle de l’entreprise contraignant les salarié∙es à prendre leurs congés sur la durée de la fermeture. Les congés payés annuels étant de 24 jours ouvrables, si l’entreprise ferme plus longtemps, l’employeur devra payer les salarié∙es pour les jours dépassant les 24 jours. 7 - Puis-je me voir imposer du travail de nuit ? Le travail de nuit ne peut être mis en place qu’à titre exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la « continuité de l’activité économique » ou des « services d’utilité sociale ». Ces justifications doivent être précisées par l’accord d’entreprise ou de branche qui met en place le travail de nuit. L’accord doit également prévoir, entre autres, les contreparties pour les salarié∙es effectuant des horaires de nuit (repos compensateur et parfois compensation salariale, temps de pause, etc..). En l’absence d’accord collectif, l’employeur ne peut pas faire passer les salarié∙es d’un horaire de jour à un horaire de nuit sauf avec l’autorisation de l’inspection du travail qui doit à son tour s’assurer que l’employeur ait bien engagé « loyalement et sérieusement » des négociations sur un tel accord. À défaut d’accord collectif ou d’autorisation de l’inspection du travail, le refus d’un∙e salarié∙e de passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit ne constitue pas une faute justifiant une sanction ou un licenciement. 8 - Puis-je être sanctionné∙e pour un retard lié à l'organisation des JO (transports, contrôle de sécurité) ? La loi ne prévoit pas de motif de retard spécifique aux perturbations engendrées par la tenue des Jeux Olympiques. Le Ministère des Transports a d’ores et déjà mis en place un site dédié à l’organisation des Jeux mais, s’il anticipe déjà de fortes perturbations des transports et des restrictions de circulation, il ne prévoit aucune mesure contraignante pour les employeurs. Attention, si vous craignez des sanctions pour des retards liés à l’organisation des JO, il peut être utile de garder la preuve : des perturbations des transports le(s) jour(s) des retards, des heures de départ du domicile afin d’attester de sa bonne foi, des éventuelles demandes d’aménagement temporaire de poste lorsque ceux-ci sont possibles (télétravail, demande de changement d’horaires, etc..). 9 - J'ai un mandat syndical (conseiller∙e du salarié, délégué∙e syndical∙e) ou de représentant∙e du personnel, peut-on me refuser l'accès à un site en raison des JO ? Certaines zones, situées à proximité des lieux d’accueil des épreuves (https://anticiperlesjeux.gouv.fr/carte-interactive-impacts-deplacements-ile-france), seront en accès restreint et nécessiteront un enregistrement préalable auprès de la préfecture de Police. Le ministère de l'intérieur a mis en ligne une plateforme afin de s'enregistrer en vue d'accéder au périmètre des JO : https://www.pass-jeux.gouv.fr/ . Si le Ministère a fait le choix de laisser la charge aux salarié.es dont les déplacements seraient impactés de solliciter un pass d'accès, l'employeur est tenu de fournir un justificatif employeur ou de mission afin que le.la salarié.e soit en mesure de justifier sa demande. Les modalités d’accès aux périmètres de sécurité ne sauraient exclure la circulation des élu∙es et mandaté∙es syndicaux sur les lieux de travail où ils et elles sont amené∙es à exercer leur mandat, sauf à porter atteinte à la liberté syndicale et au droit à la représentation. 10 - Peut-on m'imposer du télétravail pendant la durée des JO ? En principe, non. Dans beaucoup d’entreprise, le télétravail et ses modalités ont été mis en place par accord d’entreprise ou par charte établie par l’employeur. À défaut, le télétravail peut être mis en place par accord entre le ou la salarié∙e et son employeur mais ne peut être imposé unilatéralement au salarié. Attention toutefois, le Code du travail prévoit l’éventualité de « circonstances exceptionnelles » justifiant un recours au télétravail afin de « permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ». En fonction du déroulement des JO, la perturbation des transports, la fermeture de routes, certains employeurs pourraient imposer le télétravail en raison de ces circonstances exceptionnelles. 11 - Peut-on changer mon lieu de travail ? Oui. Le contrat de travail peut prévoir un lieu de travail fixe mais, lorsque ce dernier est modifié, les salarié∙es peuvent être amené∙es à suivre leur entreprise sans pouvoir refuser la modification dès lors que le nouveau lieu de travail se trouve dans le même secteur géographique. Celui-ci s’apprécie au cas par cas en fonction de la distance et des moyens de transport existant entre l'ancien et le nouveau lieu de travail. Dans plusieurs cas, l’employeur peut demander aux salarié∙es de travailler au-delà du secteur géographique : lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, par le biais d’un accord collectif, ou encore lorsqu’il justifie du caractère temporaire de la nouvelle affectation. Clause de mobilité dans le contrat de travail : la clause doit prévoir précisément une zone géographique d’application (par exemple, elle ne peut pas être définie uniquement par « partout où l’entreprise est implantée » mais elle peut recouvrir « toute la France métropolitaine »). Mobilité géographique prévue par accord collectif : un accord collectif peut prévoir la mobilité géographique des salarié∙es alors même que leur contrat de travail ne le prévoit pas. La disposition de l’accord doit alors répondre aux mêmes critères que ceux des clauses du contrat de travail et les salarié∙es doivent avoir été informé∙es de l’existence de l’accord au moment de l’embauche. Dans certains cas, l’employeur peut décider d’une mobilité géographique sans que le contrat de travail ou un accord le prévoit. Lorsque les fonctions du ou de la salarié∙e ne justifient pas, en soit, une mobilité géographique ; l’employeur peut malgré tout imposer un changement de lieu de travail mais il doit alors justifier que la mobilité géographique est « motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le/la salarié∙e est informé∙e préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ». Télécharger la charte sociale des JO 2024 signée par notre organisation ↓ , Téléchargement-s . ( - Lu) Télécharger ,
>> Lire la suite
La CGT appelle à se joindre aux rassemblements le 18 juillet (15 Juil. 2024)
Le président doit entendre le résultat des urnes et demander à la force politique qui est arrivée en tête de désigner un·e premier·e ministre Le président de la République doit arrêter d'être dans une logique partisane et appeler le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête au second tour des législatives à proposer un·e premier·e ministre qui sera chargé·e de former un gouvernement, et laisser faire ainsi le parlement et la démocratie parlementaire pour trouver des majorités de projet pour faire des réformes nécessaires au pays. 🗣️"Je suis très inquiète parce qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas compris qu'il est président de la République et qu'il doit être garant du respect des institutions, de la démocratie (...) au lieu de jeter des bidons d'essence à chaque fois qu'il y a des incendies" @BinetSophie pic.twitter.com/5HUkH8XgNr — LCI (@LCI) July 11, 2024 Emmanuel Macron doit sortir du déni et admettre sa défaite sévère À l'heure où notre pays à besoin plus que jamais d'apaisement et de rassemblement, comme à chaque fois, le président lui préfère le chaos. La lettre qu'il a adressée aux français·es suscite une grande colère qui provoquera le chaos s'il ne respecte pas le résultat des urnes. 🗣️ La lettre d'Emmanuel Macron "suscite une grande colère", et "il risque de plonger le pays dans le chaos" : @BinetSophie pic.twitter.com/YazcCxlXbW — LCI (@LCI) July 11, 2024 La nouvelle majorité Front populaire est dans la capacité de gouverner Tout comme la majorité sortante qui était relative, la nouvelle majorité Front populaire est dans la capacité de gouverner, charge à elle de trouver des alliances pour arriver à une majorité sur des projets. La démocratie des urnes, dont le président de la République est garant s'il fallait le lui rappeler, doit être respectée. La CGT appelle à mettre en place des méthodes démocratiques, en respectant la démocratie parlementaire et sociale, pour mettre fin à l'ère de la brutalisation de nos institutions par la majorité sortante et instituée par Emmanuel Macron. Le 18 juillet : pression populaire et citoyenne pour que le résultat des élections soit respecté Il y a besoin d'un changement dans les politiques économiques et sociales et la priorité pour la CGT c'est d'avoir un gouvernement quel qu'il soit qui va : abroger la réforme des retraites augmenter les salaires investir dans les services publics C'est dans ce cadre que la CGT soutien l'initiative de la CGT cheminots qui a appelé les citoyen·nnes à se réunir le 18 juillet à 12h, jour de la première session de la nouvelle législature, à proximité de l’Assemblée nationale et à proximité des préfectures pour les non parisien·nes pour mettre l'Assemblée nationale sous pressions populaire. → Télécharger le tract du 18 juillet
>> Lire la suite
Travailleuses et travailleurs des métiers saisonniers (12 Juil. 2024)
 La CGT à la rencontre des travailleurs·ses saisonnier·es
Les militant·es CGT sillonnent les stations de ski, les montagnes, les plages, les exploitations agricoles pour aller à la rencontre des travailleuses et travailleurs
saisonnier·es, afin de les informer sur leurs droits, mais aussi pour s'imprégner de leurs besoins afin de construire avec elles et eux un socle de revendications qui
corresponde à leurs exigences vis-à-vis des organisations syndicales et qu'elles et ils souhaitent voir la CGT porter.
Des offres d'emplois qui se font plus rares, des ruptures du contrat arbitraires, des périodes d'essai non respectées, l'annulation d'évènements ou l'appel au bénévolat sur des postes qui
pourraient être pourvus par des saisonnier·es. représentent autant de contraintes qui pèsent sur l'activité des saisonnier·es.
À ces difficultés, il faut ajouter :
des difficultés de logement : des conditions de logement parfois indignes (dans un parking, non-accès à un point d'eau et/ ou à l'électricité pour se chauffer, s'éclairer.),
problèmes de surface (colocation imposée.), loyers trop élevés, logements d'abord destinés à l'accueil de vacancier·es ou de touristes.
un maintien dans la précarité, notamment avec des réformes de l'assurance chômage qui ne tiennent aucun compte de la spécificité de l'activité des travailleuses et travailleurs
saisonnier·es.
des perturbations climatiques et environnementales qui impactent notamment la durée des contrats et les conditions de travail : inondations, manque de neige sur les pistes,
pluies fréquentes, canicules.
La CGT met à votre disposition le guide pratique été 2024 à télécharger pour vous aider à vous repérer et à connaître vos droits.
Vous y trouverez des informations juridiques, et tout un tas d'informations utiles sur votre contrat et vos conditions de travail, votre salaire, des informations sur l'indemnisation
chômage.
La CGT à la rencontre des travailleurs·ses saisonnier·es
Les militant·es CGT sillonnent les stations de ski, les montagnes, les plages, les exploitations agricoles pour aller à la rencontre des travailleuses et travailleurs
saisonnier·es, afin de les informer sur leurs droits, mais aussi pour s'imprégner de leurs besoins afin de construire avec elles et eux un socle de revendications qui
corresponde à leurs exigences vis-à-vis des organisations syndicales et qu'elles et ils souhaitent voir la CGT porter.
Des offres d'emplois qui se font plus rares, des ruptures du contrat arbitraires, des périodes d'essai non respectées, l'annulation d'évènements ou l'appel au bénévolat sur des postes qui
pourraient être pourvus par des saisonnier·es. représentent autant de contraintes qui pèsent sur l'activité des saisonnier·es.
À ces difficultés, il faut ajouter :
des difficultés de logement : des conditions de logement parfois indignes (dans un parking, non-accès à un point d'eau et/ ou à l'électricité pour se chauffer, s'éclairer.),
problèmes de surface (colocation imposée.), loyers trop élevés, logements d'abord destinés à l'accueil de vacancier·es ou de touristes.
un maintien dans la précarité, notamment avec des réformes de l'assurance chômage qui ne tiennent aucun compte de la spécificité de l'activité des travailleuses et travailleurs
saisonnier·es.
des perturbations climatiques et environnementales qui impactent notamment la durée des contrats et les conditions de travail : inondations, manque de neige sur les pistes,
pluies fréquentes, canicules.
La CGT met à votre disposition le guide pratique été 2024 à télécharger pour vous aider à vous repérer et à connaître vos droits.
Vous y trouverez des informations juridiques, et tout un tas d'informations utiles sur votre contrat et vos conditions de travail, votre salaire, des informations sur l'indemnisation
chômage.
 [ Télécharger la bannière web ]
,
Sommaire du guide saisonniers
Les propositions de la CGT
Revendication phare - Page 8
Qui vous protège ?
Le Code du travail - Page 10
L'application d'une convention d'entreprise ou d'un accord collectif - Page 10
L'embauche
Les règles qui s'appliquent à toutes et tous - Page 13
La visite médicale d'embauche - Page 13
La promesse d'embauche - Page 14
Le contrat de travail
Qu'est-ce qu'un contrat saisonnier ? - Page 17
Le contrat de travail - Page 18
Les mentions obligatoires - Page 18
La période d'essai
Page 17
La rémunération
Le salaire - Page 22
Le salaire socialisé - Le salaire brut - Page 22
Qu'est-ce que l'avantage en nature - Page 23
Le paiement du salaire - Page 24
Le travail dissimulé - Page 24
Explication d'une fiche de paie - Page 24
Le temps de travail
La durée légale et maximale de travail - Page 27
Les temps de pause - Page 27
Le temps d’habillage - Page 27
Le temps partiel saisonnier - Page 28
Les heures supplémentaires - Page 29
Le travail du dimanche et les jours fériés - Page 30
Le travail de nuit - Page 30
Les fiches horaires des contrats saisonniers - Page 33
Les conditions de travail
Les obligations de l’employeur - Page 35
Le droit de retrait - Page 36
Les accidents de travail et les accidents de trajet - Page 36
La sécurité au travail et le rôle de la Carsat - Page 37
La formation professionnelle avant, pendant et après la saison
Avant la saison - Page 39
Pendant la saison - Page 39
Pendant l’intersaison - Page 40
L’accès à la santé et la médecine du travail
L’assurance maladie des saisonnier·ère·s - Page 43
La complémentaire santé - Page 44
L’affiliation au médecin traitant et remboursement - Page 46
L’examen périodique de santé - Page 47
Les arrêts maladies - Page 48
Le délai pour prévenir l’employeur - Page 48
Les indemnités journalières (IJ) - Page 48
Les contrôles - Page 49
La surveillance médicale renforcée (SMR) - Page 49
Les conditions de restauration - Page 50
La grossesse - Page 50
Le congé maternité - Page 50
Le congé paternité - Page 51
La retraite
Page 52
Les aides ou allocations
Les aides publiques - Page 55
Les aides du comité social et économique - Page 55
La fin du contrat
La rupture anticipée du contrat - Page 57
Le licenciement pour motif économique - Page 57
La rupture conventionnelle homologuée du CDI ou rupture amiable du CDD - Page 57
Les droits à l’indemnisation chômage
Le chômage partiel ou activité partielle - Page 61
Le logement
Page 63
Les ouvrier·ère·s agricoles
Page 73
Hôtels, cafés, restaurants
La grille conventionnelle des salaires - Page 76
Les jours fériés - Page 76
La mutuelle obligatoire - Page 77
Des règles particulières sur le temps de travail - Page 77
Animation, centres sociaux et sport
Page 78
En cas de litige
Page 66
Les moins de 18 ans
Condition d’âge - Page 69
Les conditions de travail - Page 69
Les secteurs réglementés - Page 70
Déclarer les revenus de son job d’été ? - Page 70
Les salarié·e·s étranger·ère·s
Page 71
Salarié·e·s des remontées mécaniques et service des pistes
Page 80
Les droits collectifs
Les droits collectifs
Le droit d’expression - Page 83
Le droit de grève - Page 83
Le droit de se syndiquer - Page 83
Présentation de la CGT
es valeurs et l’histoire - Page 86
L’Histoire du monde du travail, du syndicalisme et de la CGT en particulier - Page 86
Le rôle et la place du/de la syndiqué·e dans la CGT - Page 86
Pourquoi se syndiquer ? - Page 87
La cotisation syndicale - Page 87
→ Inscrivez-vous pour télécharger le guide complet
,
Pour la tournée estivale saisonniers CGT 2024, un modèle d'affiche personnalisable est disponible en téléchargement
[ Télécharger la bannière web ]
,
Sommaire du guide saisonniers
Les propositions de la CGT
Revendication phare - Page 8
Qui vous protège ?
Le Code du travail - Page 10
L'application d'une convention d'entreprise ou d'un accord collectif - Page 10
L'embauche
Les règles qui s'appliquent à toutes et tous - Page 13
La visite médicale d'embauche - Page 13
La promesse d'embauche - Page 14
Le contrat de travail
Qu'est-ce qu'un contrat saisonnier ? - Page 17
Le contrat de travail - Page 18
Les mentions obligatoires - Page 18
La période d'essai
Page 17
La rémunération
Le salaire - Page 22
Le salaire socialisé - Le salaire brut - Page 22
Qu'est-ce que l'avantage en nature - Page 23
Le paiement du salaire - Page 24
Le travail dissimulé - Page 24
Explication d'une fiche de paie - Page 24
Le temps de travail
La durée légale et maximale de travail - Page 27
Les temps de pause - Page 27
Le temps d’habillage - Page 27
Le temps partiel saisonnier - Page 28
Les heures supplémentaires - Page 29
Le travail du dimanche et les jours fériés - Page 30
Le travail de nuit - Page 30
Les fiches horaires des contrats saisonniers - Page 33
Les conditions de travail
Les obligations de l’employeur - Page 35
Le droit de retrait - Page 36
Les accidents de travail et les accidents de trajet - Page 36
La sécurité au travail et le rôle de la Carsat - Page 37
La formation professionnelle avant, pendant et après la saison
Avant la saison - Page 39
Pendant la saison - Page 39
Pendant l’intersaison - Page 40
L’accès à la santé et la médecine du travail
L’assurance maladie des saisonnier·ère·s - Page 43
La complémentaire santé - Page 44
L’affiliation au médecin traitant et remboursement - Page 46
L’examen périodique de santé - Page 47
Les arrêts maladies - Page 48
Le délai pour prévenir l’employeur - Page 48
Les indemnités journalières (IJ) - Page 48
Les contrôles - Page 49
La surveillance médicale renforcée (SMR) - Page 49
Les conditions de restauration - Page 50
La grossesse - Page 50
Le congé maternité - Page 50
Le congé paternité - Page 51
La retraite
Page 52
Les aides ou allocations
Les aides publiques - Page 55
Les aides du comité social et économique - Page 55
La fin du contrat
La rupture anticipée du contrat - Page 57
Le licenciement pour motif économique - Page 57
La rupture conventionnelle homologuée du CDI ou rupture amiable du CDD - Page 57
Les droits à l’indemnisation chômage
Le chômage partiel ou activité partielle - Page 61
Le logement
Page 63
Les ouvrier·ère·s agricoles
Page 73
Hôtels, cafés, restaurants
La grille conventionnelle des salaires - Page 76
Les jours fériés - Page 76
La mutuelle obligatoire - Page 77
Des règles particulières sur le temps de travail - Page 77
Animation, centres sociaux et sport
Page 78
En cas de litige
Page 66
Les moins de 18 ans
Condition d’âge - Page 69
Les conditions de travail - Page 69
Les secteurs réglementés - Page 70
Déclarer les revenus de son job d’été ? - Page 70
Les salarié·e·s étranger·ère·s
Page 71
Salarié·e·s des remontées mécaniques et service des pistes
Page 80
Les droits collectifs
Les droits collectifs
Le droit d’expression - Page 83
Le droit de grève - Page 83
Le droit de se syndiquer - Page 83
Présentation de la CGT
es valeurs et l’histoire - Page 86
L’Histoire du monde du travail, du syndicalisme et de la CGT en particulier - Page 86
Le rôle et la place du/de la syndiqué·e dans la CGT - Page 86
Pourquoi se syndiquer ? - Page 87
La cotisation syndicale - Page 87
→ Inscrivez-vous pour télécharger le guide complet
,
Pour la tournée estivale saisonniers CGT 2024, un modèle d'affiche personnalisable est disponible en téléchargement
 [ Télécharger le modèle d'affiche ]
,
Tournée été 2024
La Rochelle : 12 et 13 juillet 2024
[ Télécharger le modèle d'affiche ]
,
Tournée été 2024
La Rochelle : 12 et 13 juillet 2024
 Télécharger - Format .jpg
Télécharger - Format .pdf
Cherbourg : 18 juillet 2024
Télécharger - Format .jpg
Télécharger - Format .pdf
Cherbourg : 18 juillet 2024
 Télécharger - Format .jpg
Télécharger - Format .pdf
Lourdes : 23 juillet 2024
Télécharger - Format .jpg
Télécharger - Format .pdf
Lourdes : 23 juillet 2024
 Télécharger - Format .jpg
Télécharger - Format .pdf
Télécharger - Format .jpg
Télécharger - Format .pdf
>> Lire la suite
9 raisons de se syndiquer, de s'organiser avec la CGT et de voter pour la CGT (9 Juil. 2024)
Pour ne pas tourner la page Le sursaut populaire citoyen des législatives 2024 ne doit pas s’arrêter, il doit s’organiser dans la durée. Depuis les élections européennes, des milliers de salarié·es et retraité·es ont fait le choix de se syndiquer à la CGT. Cette dynamique doit s’amplifier pour permettre aux travailleuses et travailleurs de reprendre le pouvoir sur leur travail et leur vie. À vous : cgt.fr/rejoindre. Parce que la CGT représente et défend toutes et tous La CGT est organisée sur tout le territoire (cgt.fr/ud) et dans toutes les professions (cgt.fr/federations). Que vous soyez salarié·e du privé, intérimaire, ou fonctionnaire, que vous soyez en emploi ou à la retraite, que vous soyez employé·e, ouvrier·e, cadre, ingénieur·e, ou exerçant une profession technicienne ou intermédiaire, que vous travailliez dans une multinationale, une PME ou une TPE, la CGT adapte ses structures aux réalités du monde du travail pour que chacune et chacun trouve sa place parmi les 600 000 syndiqué·es. Pour ne pas laisser les affaires du monde au monde des affaires Trop de décisions qui concernent nos emplois, nos salaires et notre planète sont prises sans nous. En nous organisant, nous pouvons reprendre la main face au pouvoir de l’argent et imposer un autre agenda que celui de la spéculation boursière et immobilière. Pour nos salaires et nos pensions, et pour l’égalité entre les femmes et les hommes Boostée par la course aux profits et aux dividendes des actionnaires, l’inflation grignote nos salaires, nos pensions et allocations. La CGT revendique des augmentations générales, une meilleure reconnaissance des qualifications par le salaire, et son indexation sur les prix. La CGT se bat également pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et la fin des temps partiels subis, pour la réduction du temps de travail et la revalorisation des métiers à prédominance féminine. Pour reprendre la main sur notre travail La démocratie ne peut pas s’arrêter aux portes des entreprises en laissant les pleins pouvoirs aux employeurs. La production, c’est nous ! Le travail c’est nous ! Les richesses c’est nous ! Nous devons donc avoir notre mot à dire sur l’organisation et les finalités de notre travail. Pour exercer nos droits fondamentaux 40 % des salarié·es n’ont pas de syndicat dans leur entreprise et les taux de participation sont souvent très bas aux élections professionnelles. Pourtant, chaque voix compte triple : dans l’entreprise, dans la branche professionnelle, et au niveau national. Pour vaincre l’extrême droite, cette imposture sociale Sous un vernis de démagogie pseudo-sociale, l’extrême droite porte un projet capitaliste, xénophobe et réactionnaire, et ne répond qu’aux intérêts des puissant·es. Elle est ainsi opposée à l’augmentation du Smic ou à la revalorisation des petites retraites, et vise une réduction de la démocratie dans les entreprises. Le progrès social nécessite donc qu’on la combatte, et la CGT agira toujours contre la propagation des idées d’extrême droite. Pour nos droits et notre avenir La CGT est indépendante des partis politiques, des employeurs et des gouvernements. Elle décide toujours avec les syndiqué·es et les salarié·es qui sont les boussoles de l’action syndicale. Créer ou rejoindre un syndicat est la meilleure manière de relever la tête face aux employeurs et leurs alliés au gouvernement qui continuent d’ignorer les besoins sociaux et l’urgence environnementale. Pour agir concrètement, ensemble La CGT rend concrète et matérielle la solidarité entre tou·tes les salarié·es. Rejoindre la CGT, ce n’est pas soutenir une personne ou une organisation, c’est s’organiser avec ses collègues et se donner les moyens de peser, grâce à une démarche collective qui vise à transformer les aspirations et les besoins de chacun·e en avancées réelles et durables. Télécharger le tract Tract modifiable Assemblage pour InDesign : Télécharger Format .docx (Microsoft Word) + polices utilisées : Télécharger Tract pour impression Format PDF pour imprimeur (avec traits de coupe) : Télécharger Format PDF pour imprimante/copieur (sans traits de coupe) : Télécharger Tract pour diffusion numérique Format PDF : Télécharger Format image (Jpeg) : Télécharger
>> Lire la suite
La démocratie et la République ont gagné ! Les exigences sociales doivent être entendues ! (8 Juil. 2024)
Le Nouveau Front Populaire, porteur d’un programme prévoyant notamment l'augmentation des salaires et des pensions, l'abrogation de la réforme des retraites et l'investissement dans nos services publics, est arrivé en tête. Espagne, Grande-Bretagne et maintenant la France : les réactionnaires sont battus sur la base d’attentes sociales fortes. En Europe, le choix est désormais clair : progrès social ou fascisme, le libéralisme n’est plus une alternative. Le président de la République a été sévèrement sanctionné. Il a été totalement irresponsable en tentant jusqu’au bout de mettre dos à dos l’Extrême droite avec la gauche, contribuant ainsi à la légitimation du Rassemblement National et de son idéologie. Heureusement, la majorité des organisations syndicales, la société civile, la jeunesse et les partis politiques républicains ont pris leurs responsabilités. Fidèle à son histoire, la CGT a continué de rappeler très fermement que le Rassemblement National est toujours un parti raciste, antisémite, homophobe, sexiste et violent et qu’il ne doit jamais être considéré comme un parti comme les autres. La CGT demande solennellement à Emmanuel Macron de respecter le choix des urnes et d’appeler à la formation d'un nouveau gouvernement autour du programme du Nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête. Au-delà, les leçons doivent être tirées en profondeur pour contrer la progression continue du Rassemblement National, qui a obtenu un nombre de député·es record. La CGT alerte. Les exigences sociales doivent être entendues : le travail doit permette de vivre dignement et les services publics doivent être développés dans tous les territoires. Pas question que le patronat, qui a brillé par sa complaisance envers l’Extrême droite, ait encore gain de cause. Il faut rassembler le pays qui a été clivé de façon très violente et lutter avec détermination contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Il faut aussi renforcer les obligations déontologiques et l’indépendance des médias actuellement dans les mains de quelques milliardaires. Le sursaut populaire citoyen ne doit pas s’arrêter, il doit s’organiser dans la durée. Depuis les élections européennes, des milliers de salarié·es et retraité·es ont fait le choix de se syndiquer à la CGT. Cette dynamique doit s’amplifier pour permettre aux travailleuses et travailleurs de reprendre le pouvoir sur leur travail et leur vie. Partout dans les territoires, la CGT va rencontrer les député·es républicains pour porter les exigences du monde du travail. La CGT va réunir ses instances de direction pour décider de toutes les initiatives nécessaires et échanger avec l’intersyndicale et les associations pour continuer à avancer dans l’unité la plus large. Télécharger le tract du 18 juillet
 Version .pdf A4 →
Version Réseaux sociaux →
Assemblage .indd →
Télécharger les visuels pour les réseaux sociaux
Version .pdf A4 →
Version Réseaux sociaux →
Assemblage .indd →
Télécharger les visuels pour les réseaux sociaux
 Plus de 80 rassemblements prévus le 18 juillet dans le cadre de l’appel de la fédération des Cheminots
Voir la liste complète
,
Plus de 80 rassemblements prévus le 18 juillet dans le cadre de l’appel de la fédération des Cheminots
Voir la liste complète
,
>> Lire la suite
Saisonniers : quels droits pour quel travail ? (7 Juil. 2024)
Voici quelques conseils de base à connaître avant de signer un contrat. L'emploi saisonnier concerne uniquement les travaux normalement appelés à se répéter chaque année, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. La saison doit avoir une durée limitée, elle ne dépend pas de la volonté de l'employeur. Un surcroît d'activité ou des travaux indépendants du rythme des saisons ne peuvent pas être considérés comme saisonniers. Il n'existe pas de contrat spécifique au travail saisonnier. Il s'agit d'un Contrat à Durée Déterminée (CDD) qui est utilisé avec quelques règles particulières. Par exemple, aucune prime de précarité n'est versée à la fin du contrat. Si un emploi n'est pas réellement saisonnier, le salarié doit toucher une prime de précarité en fin de contrat. Le contrat de travail doit être écrit et remis au salarié dans les 48 heures qui suivent son embauche. Il doit être signé par l'employeur et le salarié, qui se voit remettre une copie du document. La période d'essai n'est pas obligatoire. S'il y en a une, elle ne peut pas dépasser une durée calculée à raison d'un jour par semaine. Elle est rémunérée normalement, suivant les conditions prévues dans le contrat de travail. Au terme de la période d'essai, le salarié est embauché jusqu'au terme prévu par son contrat. Le salaire minimum d'un saisonnier dépend de sa tranche d'âge. Pour les 14-16 ans, il est de 80 % du Smic. Pour les 17-18 ans, 90 % du Smic. Au-delà de 18 ans, il doit être au moins égal au Smic. Le montant du Smic horaire brut est de 11,65 € au 1er janvier 2024. Pour 35 heures de travail hebdomadaires, cela correspond à 1 766,92 € brut. Cela représente 1 398,69 € net quand les cotisations, pour être indemnisé en cas de maladie, de chômage ou pour la retraite, ont été versées. Si le régime des congés payés dans l'entreprise ne permet pas d'en prendre, le salariés doit toucher une indemnité de congés payés pour le travail accompli. Elle correspond à au moins 10 % de la rémunération totale brute. Dans le guide saisonniers, la CGT partage également ses propositions pour améliorer le statut du travailleur saisonnier. Pour la CGT, les saisonniers ne devraient pas être enfermés dans un contrat précaire mais avoir les mêmes droits que les autres salariés. De nombreux « saisonniers » travaillent huit ou dix mois sur douze. On ne peut donc plus vraiment parler de travail saisonnier. La CGT propose un nouveau statut du travail salarié dans lequel les droits sont attachés à la personne. Des inspecteurs du travail supplémentaires devraient aussi être recrutés. Un nombre plus important de contrôles permettraient de mieux faire respecter les droits des saisonniers, et d'améliorer notamment leurs conditions d'hébergement. S'inscrire pour télécharger le guide été 2024 gratuitement
>> Lire la suite